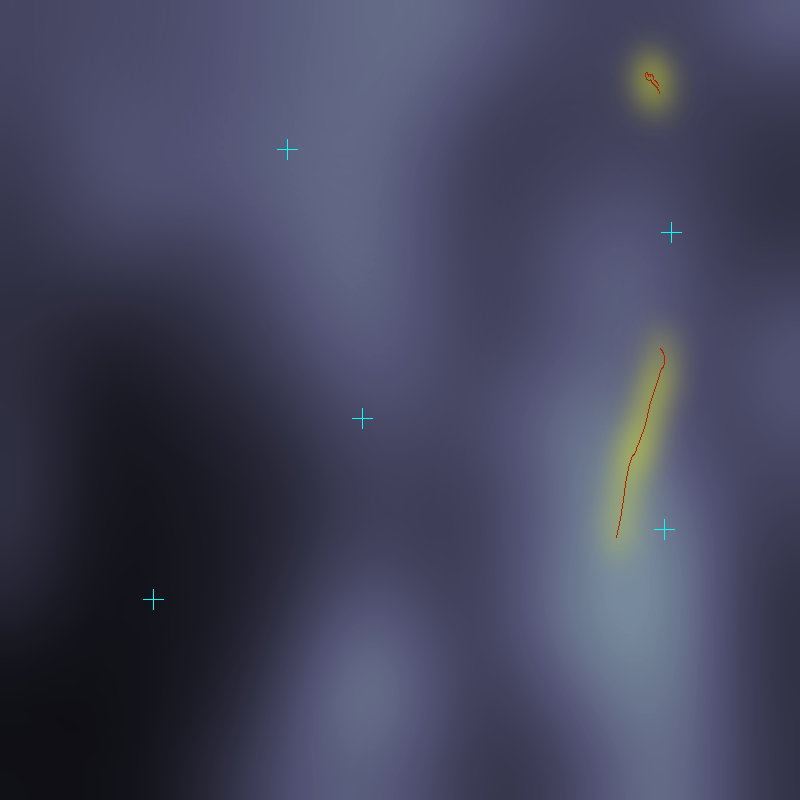
+
- 13-06-2022
- Quentin Gilliotte
Recherche
Audiovisuel
Musique
Recherche
Audiovisuel
Musique
Les biens culturels physiques résistent à la numérisation
À partir d'une soixantaine d'entretiens et d'une enquête quantitative, Quentin Gilliotte, docteur en sociologie, revient sur la « persistance » du recours aux biens culturels physiques.
Pourquoi continuer à acheter et à mobiliser des vinyles, des CD, des DVD ? Pourquoi prendre le temps de déposer un vinyle sur une platine ? Pourquoi vouloir accumuler l’entièreté des coffrets DVD de sa série préférée ?1
Dans le cadre de la consommation de biens culturels, la transition du physique au numérique ne fait aucun doute. Les ventes de CD et de DVD se sont effondrées, tandis que le téléchargement puis le streaming en ont l’un après l’autre pris le relais (Gfk, 2020;2 SNEP, 20193). Dans les secteurs de la musique et de la vidéo, l’année 2018-2019 a été le pivot de cette transition : le marché des ventes numériques de musique a dépassé celui des ventes physiques en France grâce au streaming audio, tandis que sur le marché de la vidéo, les trois modes de consommation dématérialisée dépassent les 60% du marché.
Paradoxalement, malgré la numérisation des pratiques, plusieurs phénomènes montrent la persistance (parfois même le renouveau) de la consommation culturelle des biens physiques. Ainsi, 53,2 millions de DVD ont été achetés en 2018 (Gfk, 20194). En 2018, ce sont plus de 3,5 millions de vinyles qui ont trouvé preneurs, contre 3,15 en 2017 - soit une augmentation de 11 points (SNEP, 20195), représentant 20% du marché physique de la musique. La même année, la vente de CD rapportait toujours près de 200 millions d’euros (SNEP, 2018). Évidemment, ces données ne prennent en compte que les acquisitions récentes et laissent donc dans l’ombre les ventes de biens culturels d’occasion, qu’il s’agisse des cassettes audio, cartouches de Super Nintendo, laser-discs et autres formats plus ou moins vintage ou susceptibles de compléter les collections d’afficionados. En outre, peu d’études statistiques renseignent sur la façon dont les biens physiques déjà accumulés par le passé sont de nouveau mobilisés.
Deux discours sont souvent associés à cet équilibre entre physique et numérique. D’une part, le numérique s’articule autour d’une double promesse d’accessibilité. L’offre, pléthorique, paraît infinie et les catalogues gagnent un nombre colossal de références au fur et à mesure de leur existence, entre nouvelles productions et acquisition de licences déjà existantes. Par ailleurs, le numérique présente cet autre avantage de fortement réduire les contraintes d’accès aux biens. Écouter de la musique ou regarder des films et séries via Deezer, YouTube, Netflix et consorts peut se faire effectivement presque n’importe où, n’importe quand, sur presque n’importe quel support technologique, qu’il s’agisse d’ordinateurs fixes, portables, de téléphones ou de tablettes. Comment alors ne pas préférer le numérique ? Pour autant, la dématérialisation des biens culturels a été également associée à une « dépossession » : avec le numérique, on ne possèderait plus les biens culturels. Certains collectionneurs, amateurs et experts s’émeuvent alors de la perte du support, perte d’affection, perte d’attachement, signe même d’une « impossession » (Chantepie, 20176; Petrover, 20157).
Si plusieurs travaux ont montré l’importance du livre papier et de la dimension sensorielle de la pratique qui y est adossée (Guittet, 20208), en revanche l’importance de la matérialité des biens médiaculturels (musique, séries, films et jeux vidéo) a été bien moins traitée. Les études sur le tournant numérique ont en partie masqué le questionnement sur la rémanence de formats antérieurs. Ainsi, les usages des biens médiaculturels numériques ont été largement étudiés(Béchec et al., 20149; Beuscart, 201710; Granjon & Combes, 200811; Le Guern, 201612; Perticoz, 200913), tandis que les travaux sur la persistance des biens physiques sont bien plus rares. Les quelques-uns publiés ces dernières années (Chaney, 200914; Legault-Venne et al., 201615; Magaudda, 201116; Nguyen et al., 201417) se focalisent principalement sur le cas de la musique. Quelle place ont les biens culturels physiques aujourd’hui ?
Pour répondre à cette question, nous nous appuyons sur plus de soixante entretiens semi-directifs approfondis, diversifiés en termes d’âge, d’origine sociale, de niveau de diplôme et de lieu de résidence, ainsi que sur les résultats d’un questionnaire administré auprès de plus de 2000 répondants, par méthode des quotas à partir des variables de niveau de diplôme, d’âge, de genre et de PCS.
Les résultats de l’enquête quantitative ont permis notamment de fournir des données de cadrage de première main sur la question du recours aux biens culturels physiques et numériques. Ainsi, il a été demandé aux répondants d’indiquer les supports qui avaient été mobilisés sur les trente derniers jours, parmi des supports physiques (CD, DVD, vinyle, cassettes, laser-discs, jeux vidéo en boite ou cartouche) et des supports numériques (aussi bien en streaming que téléchargés). Autant le recours aux biens numériques chute brutalement à mesure qu’augmente l’âge des répondants, autant le recours aux biens physiques « résiste » bien davantage. Alors que 37% des 50-64 ans ont mobilisé un support CD sur les 30 derniers jours, ils sont 21% des 15-24 ans à l’avoir fait également sur la même période. L’écart est encore plus faible pour le DVD, avec respectivement 27% et 34% pour les mêmes classes d’âge. Comment expliquer cette persistance du recours aux biens physiques, y compris chez les plus jeunes ? Les résultats de l’enquête montrent que le recours aux biens physiques s’articule autour de deux pôles, opposant facilité et contrainte.
Les avantages pratiques des biens culturels physiques
D’une part, ces supports physiques présentent des avantages « pratiques », favorisant pour beaucoup d’enquêtés leur mobilisation au quotidien, qu’il s’agisse de les reconsommer, de les avoir à portée de main, de les faire circuler. L’immédiate disponibilité des supports physiques dans l’espace domestique est souvent présentée comme un avantage décisif. Les objets étant à disposition, ils peuvent être facilement saisis, manipulés, et évidemment consommés. C’est également ce qui ressort de l’enquête quantitative, puisque 84% des personnes interrogées étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec l’affirmation suivante « avec le numérique on ne possède pas vraiment les biens culturels que l’on consomme ». Or certaines œuvres se « doivent » d’être possédées, parce qu’elles importent particulièrement aux yeux de certains individus et parce que la matérialité de l’objet est parfois insubstituable avec les biens numériques.
D’après les personnes interrogées, les achats de biens physiques se font rarement dans le cas d’une première consommation. Notamment chez les individus qui ont l’habitude de recourir au numérique, les biens physiques ne sont pas (plus) achetés pour découvrir, mais pour reconsommer des contenus déjà connus, entendus, vus. Dans le cas de la musique, l’écoute numérique permet ainsi de se rassurer sur la qualité d’un album (Karpik, 200718), tandis que le streaming vidéo va rassurer sur la qualité d’une série ou d’un film. Le passage à l’achat du bien physique se fait donc lorsque l’incertitude sur l’adéquation de l’œuvre aux goûts du consommateur est très basse. La perspective de reconsommation est donc souvent le moteur de l’achat d’un bien physique, justement parce que le bien ainsi acquis est facilement mobilisable. Mettre un CD ou un DVD dans son lecteur est une opération qui laisse très peu d’enquêtés de côté, tant en termes de compétences que d’équipement. Le numérique permet d’éviter l’erreur, le mauvais achat, celui qu’on va regretter parce qu’il n’aura servi à rien. Et les supports physiques permettent en revanche de conserver durablement, sans inquiétude sur la volatilité des catalogues de certaines plateformes.
On retrouve très fréquemment l’idée que certains supports physiques seraient probablement plus durables que leur version numérique. Ils seraient moins fragiles, moins sujets aux dysfonctionnements de la technique. Acheter des biens physiques, c’est miser sur la pérennité de l’usage. C’est notamment les enquêtés les plus âgés qui paraissent préoccupés par cette question, à l’inverse des plus jeunes.
Enfin, il est important de posséder des biens physiques pour pouvoir les partager, ce qui peut paraître paradoxal dans la mesure où c’est une promesse du numérique que de permettre une meilleure circulation des contenus et une plus grande accessibilité. Pourtant, de nombreux contenus restent inaccessibles si les individus n’ont pas les bons abonnements, ne mobilisent pas telle plateforme, ou ne souhaitent pas nécessairement dépenser dans certains biens. En particulier pour les biens non accessibles gratuitement, « l’objet » physique revêt une importance bien supérieure à la version numérique au sein des échanges et des dons entre individus.
Des contraintes faites vertus : la singularisation de l’expérience culturelle
D’autre part, ces biens présentent également un certain nombre de contraintes faites vertus, qui viennent alimenter le plaisir et permettent de recréer de la rareté, de la singularité dans l’expérience de consommation. Les biens numériques étant standardisés – impossible de distinguer la copie d’un fichier numérique d’une autre copie – ils ne vieillissent pas, n’acquièrent pas d’unicité avec le temps : ils ne se singularisent pas. Recourir aux biens physiques permet justement de retrouver cette singularité, ce hic et nunc pour reprendre les termes de Walter Benjamin (193919).
L’esthétique d’une pochette vinyle, le livret du CD, la place qu’occupe un coffret intégral de telle saga ou telle série dans l’espace domestique… C’est par les sens que se traduit cette affinité supérieure avec ces supports physiques, comme le montrent notamment Bartmanski et Woodward au sujet du vinyle (Bartmanski & Woodward, 201520). Pour bon nombre d’individus continuant à acquérir des biens physiques, à bien des égards, les versions « physiques » sont perçues comme étant les « vrais » supports des biens. La copie numérique, perçue comme ayant moins de valeur que la copie physique, n’est finalement qu’un ersatz de l’œuvre elle-même pour bon nombre de ces enquêtés qui continuent de mobiliser les supports physiques. Cet ersatz est suffisant la plupart du temps, mais il est vu par certains comme n’étant qu’un substitut à la « vraie » chose.
Les biens culturels physiques font également l’objet d’une forte ritualisation des pratiques, en particulier chez les amateurs les plus investis mais dont le rapport esthétique peut se déployer autant vers des biens très légitimes (films d’auteurs, musique classique) que des biens peu légitimes (dessin animé, jeux vidéo, variété, etc.). Parce qu’ils répondent à des contraintes techniques et à de moins grandes facilités d’accès, leur mobilisation est plus coûteuse. Là encore, cet effort supplémentaire nécessaire à leur mobilisation vient servir un rapport esthétique aux œuvres, où la contrainte sert la satisfaction. Cette ritualisation passe premièrement par la difficulté que représente parfois leur acquisition. Parce qu’ils ne sont pas immédiatement accessibles, contrairement par exemple aux biens en streaming ou en téléchargement, ils nécessitent une organisation et des déplacements en magasins ou des livraisons. Leur rareté favorise l’investissement émotionnel, ce qui ressort d’autres études menées notamment sur l’expérience esthétique de la musique numérique (Hanrahan, 201821). Le fait d’être obligé de retarder l’accès au bien est souvent vu comme une façon d’entretenir une certaine frustration et donc une certaine excitation lorsque l’objet est enfin à portée de main. On retrouve ainsi, chez les consommateurs intensifs de streaming, une certaine nostalgie pour ces modes d’acquisition qui permettaient de différer leur plaisir.
Les biens physiques sont également mobilisés dans des cadres particuliers durant leur consommation. Premièrement, ils servent à favoriser, presque par contrainte, une consommation attentive. Notamment dans le cas du vinyle et du CD, les contraintes des supports vont inciter à respecter l’intégrité de l’album : les individus vont « se poser », et souvent se mettre dans une posture de disponibilité, même si cela n’empêche pas d’autres activités en parallèle. Ces supports sont donc mobilisés durant des moments qui vont favoriser une certaine attention à l’œuvre. C’est aussi l’occasion de faire preuve de formalisme dans la consommation : on va préparer de quoi boire et manger pour ne pas avoir à se déplacer, on va sortir l’objet de son contenant, l’insérer dans le lecteur…
Si, en soi, le fait de se préparer à une consommation attentive fait partie de l’expérience ordinaire de consommation des biens culturels, ce qui est intéressant, c’est la signification particulière que prend cette pratique pour des individus avec une forte consommation de biens numériques. Alors que la consommation des différents biens culturels reproductibles ne cesse de s’accroitre, l’hétérogénéité des supports disponibles permet de faire varier les plaisirs et les usages en créant, par l’intermédiaire des biens culturels, des « moments », suspendus, uniques. Les enquêtés semblent souligner souvent un rapport inversement proportionnel entre le « charme » des supports et leur praticité. C’est prendre le temps de déposer pleinement son attention sur l’objet. Parce que l’objet physique se singularise, parce qu’il vit indépendamment, l’expérience de consommation s’en trouve également affectée.
Conclusion
Le recours aux biens physiques peut se faire rarement ou juste de temps en temps, mais être hautement significatif pour les individus, d’autant plus quand ceux-ci mobilisent des formats numériques au quotidien. Les individus font eux-mêmes la démarche de (re)trouver une unicité de l’expérience de consommation en réinjectant de la rareté et parfois même certaines formes de frustration en entretenant volontairement une distance avec certains biens culturels. Ils recréent alors la singularité à la fois par la dimension sensorielle des biens physiques, et par la ritualisation de ces moments d’acquisition (le retour en magasin, les formes de déambulation) et des moments de consommation. L’acquisition physique de biens culturels continue à se faire dans un certain nombre de cas précis qui ne dépendent ni de contraintes techniques, ni d’un problème de compétences, ni de simples phénomènes de circulation ou de don : ils « répondent » à des besoins spécifiques, dans certaines situations, et s’avèrent complémentaires de l’offre numérique. On voit à l’œuvre le travail réflexif des individus qui cherchent à accroître le plaisir, à trouver les assemblages sociotechniques qui produisent sur eux le plus d’effets, et leur permettent d’accéder à une forme de singularisation de l’expérience de consommation.
Notes
- ↑
Ceci est un résumé de l’article publié dans la revue Biens symboliques / Symbolic Goods (Gilliotte, 2021). https://doi.org/10.4000/bssg.864
- ↑
Gfk. (2020). Baromètre CNC-GfK 2019 de la vidéo physique. Accessible en ligne.
- ↑
SNEP. (2019). Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée. Accessible en ligne.
- ↑
Gfk. (2019). Baromètre CNC-GfK de la vidéo physique 2018. Accessible en ligne.
- ↑
SNEP. (2019). Bilan 2018 du marché de la musique enregistrée. Accessible en ligne.
- ↑
Chantepie, P. (2017). L’accès illimité ou l’impossession culturelle ? Nectart, 1, 137‑146.
- ↑
Petrover, B. (2015). Ils ont tué mon disque ! First.
- ↑
Guittet, E. (2020). “Moi, il me faut du papier”. Analyse d’une difficile et inégale conversion des lecteurs de romans au numérique. Biens symboliques – Symbolic goods, 7.
- ↑
Béchec, M. L., Crépel, M., & Boullier, D. (2014). Modes de circulation du livre sur les réseaux numériques. Études de communication. langages, information, médiations, 43, 129‑144. https://doi.org/10.4000/edc.6031
- ↑
Beuscart, J.-S. (2017). A la recherche de la découverte musicale. Une exploration du régime exploratoire. In Dominique Pasquier (Dir.), Explorations Numériques. Hommages Aux Travaux de Nicolas Auray.
- ↑
Granjon, F., & Combes, C. (2008). La numérimorphose des pratiques de consommation musicale. Réseaux, n° 145-146(6), 291‑334. https://www.cairn.info/revue--2007-6-page-291.htm.
- ↑
Le Guern, P. (2016). Où va la musique ? : Numérimorphose et nouvelles expériences d’écoute (1re éd.). Transvalor - Presses des mines.
- ↑
Perticoz, L. (2009). Les processus techniques et les mutations de l’industrie musicale : L’auditeur au quotidien, une dynamique de changement [Thesis, Université Stendhal (Grenoble)].
- ↑
Chaney, D. (2009). Pourquoi acheter un CD quand on peut le télécharger ?, Abstract. Management & Avenir, 20, 30‑48.
- ↑
Legault-Venne, A., Laplante, A., Leblanc-Proulx, S., & Forest, D. (2016). Du vinyle à YouTube : Les habitudes de consommation et de recherche de musique des jeunes adultes québécois. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 11(2). https://doi.org/10.21083/partnership.v11i2.3711
- ↑
Magaudda, P. (2011). When materiality ‘bites back’ : Digital music consumption practices in the age of dematerialization. Journal of Consumer Culture, 11(1), 15‑36. https://doi.org/10.1177/1469540510390499
- ↑
Nguyen, G. D., Dejean, S., & Moreau, F. (2014). On the complementarity between online and offline music consumption : The case of free streaming. Journal of Cultural Economics, 38, 315‑330. https://doi.org/10.1007/s10824-013-9208-8
- ↑
Karpik, L. (2007). L’économie des singularités. Gallimard.
- ↑
Benjamin, W. (1939). L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Paris, Gallimard
- ↑
Bartmanski, D., & Woodward, I. (2015). The vinyl : The analogue medium in the age of digital reproduction. Journal of Consumer Culture, 15(1), 3‑27. https://doi.org/10.1177/1469540513488403
- ↑
Hanrahan, N. W. (2018). Hearing the Contradictions : Aesthetic Experience, Music and Digitization. Cultural Sociology, 12(3), 289‑302. https://doi.org/10.1177/1749975518776517