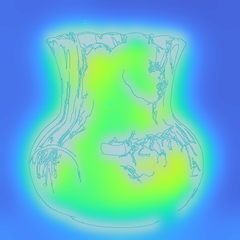
+
- 09-09-2025
- Yan Bazier
- Jaércio da Silva
Recherche
Art
Éthique du numérique
Pluralisme culturel
Recherche
Art
Éthique du numérique
Pluralisme culturel
Delacroix, De Vinci, Molière, Fauré… sont-ils de retour ?
Une analyse du rôle de l'IA dans le prolongement de la vie des oeuvres des artistes.
L'IA prolonge-t-elle la vie des œuvres et des artistes ? En brouillant les frontières entre passé et présent, vivant et disparu, permet-elle d’envisager de nouvelles formes de transmission, de reconstitution et même de prolongement de l’acte artistique ? Or, que signifie vraiment faire œuvre à partir d’un héritage ?
L’IA s’impose aujourd’hui comme un nouvel outil de transmission et de création dans le champ culturel. En s’appuyant sur les œuvres et les archives d’artistes disparus, elle permet d’enrichir leur héritage, de le rendre accessible autrement, voire de le prolonger. Ces démarches interrogent la place de la technologie dans la patrimonialisation, mais aussi dans la production d’œuvres inédites nourries du passé. Dans cet article, nous explorons quatre types d’expérimentations en cours qui sont symboliques des usages de l’IA dans la création avec des artistes morts : entre patrimoine historique et production interprétative, entre reconstitution, relecture et médiation.
Faire vivre les œuvres autrement
L’IA est devenue un allié (inattendu ?) de la mémoire culturelle. Elle permet non seulement de conserver des traces du passé, mais aussi de les enrichir, les explorer et, parfois, les transformer. Dans le domaine des arts, la patrimonialisation se conjugue désormais à des technologies d’analyse, de simulation et de reconstitution dans la recherche d’un nouvel élan aux œuvres et aux artistes disparus.
Faire revivre un patrimoine par le biais des technologies sans jamais prétendre remplacer la main de l’artiste, telle est l'intention du projet de restauration des peintures murales de Delacroix à la bibliothèque de l’Assemblée nationale.1 Mené par Barthélémy Jobert, historien de l’art à Sorbonne Université, et Aline Moskalik-Detalle, restauratrice en chef, ce travail mobilise l’IA et la visualisation 3D pour analyser les techniques picturales de l’artiste. L’objectif : identifier de nouvelles œuvres qui lui seraient attribuables en examinant un vaste corpus numérique composé des écrits, peintures, dessins et estampes de Delacroix. Au-delà de la recherche, ce projet entend également valoriser et diffuser plus largement l’héritage du peintre. Ainsi, les peintures murales seront numérisées pour permettre au grand public une exploration de son art, souvent difficile d’accès in situ. En outre, cette initiative prévoit la reconstitution en trois dimensions du décor disparu du Salon de la Paix de l’Hôtel de Ville de Paris, détruit lors de l’incendie de 1871 en s’appuyant sur les études préparatoires de Delacroix et sur l’analyse d’œuvres comparables encore visibles aujourd’hui.
Cette démarche illustre une nouvelle forme de démocratisation par la technique : rendre une œuvre accessible, même à distance, grâce aux outils numériques : la visualisation 3D devient une forme d’accès augmenté à des lieux fragiles ou fermés ; et l’IA permet de relier, comparer et produire des analyses. Ce type d’approche contribue aussi à la formation de nouvelles compétences, tant dans la recherche que dans les métiers de la restauration et de la médiation culturelle.
De nouvelles formes de transmissions possibles
À l’échelle de l’histoire de l’art, ce que nous connaissons d’un artiste n’est souvent qu’un fragment de son œuvre. Le reste demeure dans l’ombre, souvent inaccessible au grand public. Prenons l’exemple de Léonard de Vinci. Peintures, croquis, écrits, inventions fantastiques, études anatomiques, ce virtuose a été un véritable couteau suisse de son vivant. Pour autant, le grand public ne connaît qu’une minorité de ce qu’il a fait, et l’associe communément qu’à La Joconde. Google Arts & Culture a donc essayer de comprendre le visionnaire qu’était Léonard de Vinci en donnant vie à ses œuvres. Avec Dans l'esprit d'un génie,2 le musée en ligne du géant de la recherche met en lumière les inventions et créations artistiques de l'artiste avec l’aide de l’intelligence artificielle. Grâce à l’aide de 28 institutions internationales (musées, bibliothèques, fonds culturels, etc.), plus de 1 300 pages de dessins réalisés à la main et d’annotations ont été rendues publiques. Il est possible de prendre connaissance de son Codex Atlanticus, habituellement conservé à la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, qui révèle son ambition de voler, ses réflexions sur l’art florentin ou encore le curriculum vitae de Léonard de Vinci envoyé au duc de Milan. Par ailleurs, Google a fait appel à son IA pour modéliser en 3D ses inventions militaires, mécaniques et hydrauliques, dont certaines n’ont jamais vu le jour de son vivant. Ce projet ne s’intéresse cependant pas seulement à l’inventeur, mais aussi à l’artiste en rassemblant pour la première fois ses œuvres conservées habituellement dans divers musées du monde, du Portrait de Ginevra de' Benci (Washington National Gallery of Art) à La Joconde (Musée du Louvre), en passant par son célèbre autoportrait à 65 ans. Ces usages des nouvelles technologies montrent que celles-ci deviennent désormais des outils de médiation et de transmission, pour accéder autrement à une pensée et à une esthétique
Google Arts & Culture n’est cependant pas le seul à s’être attelé à faire connaître au grand public l’immensité de l’œuvre de Léonard de Vinci. En janvier 2022, le X Media Art Museum (XMAM), musée turc consacré aux nouveaux médias et à l’art numérique, a inauguré sa toute première exposition : Leonardo Da Vinci : Wisdom of AI Light Exhibition, conçue par le studio primé Ouchhh.3 Ici encore, l’intelligence artificielle est mobilisée comme vecteur de médiation, mais selon une logique esthétique radicalement différente. Loin d’une restitution fidèle ou d’une navigation archivistique, l’exposition propose une relecture immersive et sensorielle, fondée sur la projection de données artistiques traduites en langage visuel. Les dessins, croquis et schémas mécaniques de Léonard de Vinci sont analysés, modélisés en 3D, puis transformés par l’IA en environnements visuels abstraits, composés de 15 milliards de coups de pinceau numériques projetés sur les murs et le sol. L’expérience ne vise donc pas à « montrer », mais à faire ressentir, interpréter et traverser son univers à travers un langage esthétique abstrait.
En juxtaposant ces deux approches – l’une encyclopédique et pédagogique, l’autre immersive et sensorielle – on voit comment l’IA ne se contente pas d’archiver ou de reconstituer. Elle permet également de réconfigurer les modalités d’interaction avec un héritage, en donnant accès à des formes de connaissance augmentée ou d’expérience esthétique alternative. Ces dispositifs questionnent ainsi la nature même de la transmission culturelle : ne s’agit-il plus seulement de conserver des œuvres, mais aussi de les rejouer et de les traduire dans les langages perceptifs contemporains ? À travers ces exemples, nous pourons faire l’hypothèse que l’IA devient un acteur de médiation culturelle à part entière, capable de prolonger l’œuvre d’un artiste non plus par la copie, mais par l’interprétation.
Imaginer l’inédit avec les morts
L’IA ne se contente pas d’analyser le passé, elle peut aussi le prolonger, voire l’imaginer. C’est dans cette optique que Coraline Renaux, doctorante en littérature française à Sorbonne Université et le collectif d’artistes Obvious, pionnier de l’art génératif, ont imaginé Molière Ex Machina. À partir d’une question uchronique : « qu’aurait écrit Molière s’il avait vécu au-delà de 1673 ? »,les auteur.es ont initié un processus créatif mêlant théâtre, IAG et savoirs interdisciplinaires. C’est ainsi que L’Astrologue ou les Faux Présages a vu le jour, une pièce inspirée de l’univers de Molière et nourrie des expertises littéraires, historiques, scientifiques et artistiques. Avec l’aide de l’entreprise française Mistral AI, chercheurs, artistes, historiens, comédiens, musiciens et décorateurs ont coopéré pour faire naître une « œuvre nouvelle ».4 Grâce à ce dialogue entre individus et machine sont créés les textes, la musique, les décors et les costumes d'une pièce dont les premières représentations sont prévues au printemps 2025. Le théâtre, par nature éphémère et incarné, se prête ici à une expérience de continuité créative. Molière Ex Machina invite à considérer Molière comme un « vivant conceptuel », c’est-à-dire un « cadre de création » composé d'ensembles de formes, de thèmes et d’élans encore capables de résonner avec notre époque. L’intelligence artificielle intervient comme un outil d’exploration, mais c’est bien l’humain, par sa lecture sensible et savante des textes, qui reste au cœur du travail créatif. Ce type d’initiative, à la frontière entre la recherche et la création, interroge néanmoins la notion même d’auteur. Une œuvre ainsi produite peut-elle être dite de Molière, de l’IA ou bien de ses concepteurs ? Que reste-t-il de l’intention de l’auteur dans une pièce qu’il n’a jamais écrite ? Plutôt que de trancher, cette démarche met en lumière une autre facette de l’IA pour les industries culturelles :l’exploration de nouveaux possibles des œuvres et des auteurs qui existent dans l'imaginaire collectif et qui ont déjà connu une forme de reconnaissance de la part du public.
Comme le théâtre, la poésie est un exercice de liberté. Alors, comment peut-elle se produire par l’intermédiaire des machines ? Là encore, l’IA ne prétend pas imiter ou remplacer, mais interroger la manière dont une œuvre peut évoluer, être rejouée, prolongée. C’est tout l’enjeu du projet Les Fabulations de La Fontaine, imaginé par l’artiste Filipe Vilas-Boas.5 À partir des écrits de Jean de La Fontaine, un réseau antagoniste génératif a été entraîné pour générer de nouvelles fables. Le principe est simple : le visiteur choisit deux animaux sur une interface interactive et une plume robotisée se charge d’écrire le texte sous les yeux du public. Bien que cette œuvre respecte certaines caractéristiques inhérentes aux fables de Jean de la Fontaine, elle ne se contente pas de pasticher : chaque apologue est unique et accompagné d’une morale originale. L’IA devient-elle un outil de médiation et d’exploration permettant de faire revivre un auteur disparu ?
Faire parler les défunts
Une autre frontière franchie par l’IA dans sa relation aux artistes disparus, c’est sans doute celle de la parole restituée. Il ne s’agit plus simplement de simuler un style, de prolonger une œuvre ou de reconstituer un univers, mais bien de faire dialoguer les vivants avec les morts, par le truchement de technologies génératives et interactives. C’est tout le pari d’un projet présenté en 2024 lors d’une soirée organisée par l’Institut des Transformations Numériques de Mines Paris - PSL, à la Salle Cortot, à Paris.6 À cette occasion, un avatar numérique de Gabriel Fauré, compositeur majeur de la musique française, a été mis en scène dans une installation multimédia.
Grâce à un dispositif mêlant théâtralisation, reconnaissance vocale, modélisation 3D et intelligence conversationnelle, les visiteurs pouvaient interagir directement avec une projection de Fauré sur écran. L’avatar était programmé pour répondre à des questions sur sa vie, ses œuvres, ses influences, et même de commenter des aspects de la création musicale contemporaine, dans un dialogue semi-scripté nourri d’archives et d'analyses stylistiques. Ce dispositif ne visait ni à figer un mythe, ni à reconstruire un homme, mais à offrir une expérience sensible et réflexive sur la mémoire d’un artiste, sur ce qu’il reste de lui à travers ses mots, ses gestes, son esthétique. Plus qu’un gadget technologique, cette résurrection virtuelle questionne la nature de notre rapport au patrimoine : qu’attendons-nous des figures du passé ? De l’inspiration, de la transmission, du dialogue ?
Comme avec Molière Ex Machina ou Les Fabulations de La Fontaine, l’avatar de Gabriel Fauré donne à voir une autre manière de faire œuvre à partir d’un héritage : non plus seulement reconstituer ou prolonger, mais entrer en conversation, en imaginant ce que pourrait être la voix, la pensée, le regard d’un artiste sur notre époque. Ces initiatives nous rappellent que les morts ne sont pas figés dans le marbre de l’histoire, ils peuvent encore nous parler, pour peu qu’on invente les langages pour les entendre.
Pour ne pas conclure…
Entre restitution, interprétation et projection, l'IA participe à une redéfinition de l’usage du patrimoine culturel. Il n’est plus uniquement question de conserver des traces du passé, mais de les projeter vers le futur. Les expérimentations esquissent un autre rapport au temps, où la création n’est plus pensée comme un acte ponctuel et figé, mais comme un continuum ouvert à l'interprétation. Dans ce contexte, les institutions culturelles voient-elles leur rôle évoluer ? Elles ne se limitent plus à préserver ou diffuser, mais se transforment en espaces de productions de formes immersives, participatives et évolutives. L’IA permet-elle de concevoir des expériences où les usagers contribuent à la mémoire collective ?
Néanmoins, malgré l’intérêt croissant que ces expériences suscitent auprès des acteurs publics et privés, elles ne sont pas sans soulever des questionnements. Ces réflexions sont d’autant plus nécessaires que ces expérimentations, bien que récentes, reposent souvent sur des figures patrimoniales majeures, dont le prestige agit comme un cadre rassurant pour les concepteurs comme pour les publics. Elles s’inscrivent ainsi dans un mouvement d’innovation maîtrisée, mais posent la question de leur devenir une fois ce corpus emblématique épuisé. Que produiront-elles au-delà des grands noms du patrimoine ? Elles pourront alors soit se figer dans la répétition, soit devenir le socle d’une nouvelle forme d’art numérique, qui ne se limite plus à la restitution mais assume pleinement la création à partir d’une mémoire partagée. Car si l’IA permet de rendre plus vivant et engageant le parcours des publics, elle peut aussi devenir un véritable langage artistique en soi, à condition d’en faire autre chose qu’un simple levier d’interactivité. L’enjeu serait alors de ne pas s’en tenir à une logique de reproduction, mais d’ouvrir ces technologies à d’autres formes de création exploratoires ?
Il faut aussi souligner que ces démarches s’appuient sur des figures très visibles, dont l’abondance des archives et la notoriété permettent à la fois de nourrir les algorithmes et de garantir un intérêt auprès du grand public. En cela, ces noms agissent-ils comme des garanties de qualité, facilitant la réception des projets ? Mais qu’en est-il des artistes moins connus, ou dont on dispose moins d’information, pour lesquels les données sont rares et la reconnaissance plus fragile ? Le risque est réel que ces nouvelles formes de valorisation du patrimoine renforcent les déséquilibres existants, par exemple dans le rôle des femmes artistes. Enfin, d’un point de vue économique, travailler sur des figures célèbres permet de réduire l’incertitude : ce sont des créations très couteuses (en temps et en argent), ce qui en fait des objets culturels stratégiques pour les institutions qui les financent.